 Cet été, Hélène a montré le thème de Daniel dans la fosse aux lions sur des chapiteaux à Charlieu et à Moissac. J’ai alors pensé qu’il faudrait que je vous en montre de Poitiers. Et voilà, c’est fait.
Cet été, Hélène a montré le thème de Daniel dans la fosse aux lions sur des chapiteaux à Charlieu et à Moissac. J’ai alors pensé qu’il faudrait que je vous en montre de Poitiers. Et voilà, c’est fait.
Parmi les épisodes de la vie de Daniel (voir la Bible, livre de Daniel, ou pour un résumé, l’histoire illustrée par l’art), prophète de l’Ancien Testament, le plus représenté sans doute dans nos églises est celui de la fosse aux lions. Sur ce site dont je vous ai parlé, le chapiteau de l’église Sainte-Radegonde est aussi présenté, ainsi que celui de Moissac… Daniel est condamné par Darius à être dévoré par les lions suite à une dénociation calomnieuse. Il s’en sort indemne. Mais l’histoire est moyennement morale, puisque ce sont les dénonciateurs de Daniel qui sont dévorés par les lions… Dieu aurait pu aussi épargner ceux-ci, non ? (dans la Bible, toute l’histoire dans Daniel 6.2-29).
L’église Sainte-Marie-Hors-les-Murs prend le nom de Sainte-Radegonde dès que celle-ci y est enterrée en 587. Mais il ne reste rien en élévation de cette première église. Dans son état actuel, l’église date des XIe (clocher, une partie du chœur et du déambulatoire) et XIIIe siècle (nef et chœur gothique), puis à la fin du XVe siècle, des éléments sont ajoutés (chapelle, niches dans la façade, parvis où se rendait la justice du chapitre), sans compter les nombreuses restaurations.
Les chapiteaux du chœur, du déambulatoire et des absidioles datent de l’époque romane (fin du XIe siècle, entre l’incendie de 1083 et la consécration de l’église en 1099). Le chapiteau avec Daniel dans la fosse au lion est l’un de ceux-là. Les deux lions lèchent les pieds de Daniel, alors qu’un ange le protège et amène (au bout de sa main droite) le prophète Habaquq qui, en haut à gauche du chapiteau, apporte du ravitaillement à Daniel.
 Ce chapiteau porte sur sa face donnant sur le déambulatoire la Tentation d’Adam et Ève (retrouvez ici la Tentation de la façade de Notre-Dame-la-Grande). Mes photographies ne sont pas terribles, mais vous en trouverez de plus belles sur cette page consacrée à l’art roman de Poitiers [lien actualisé].
Ce chapiteau porte sur sa face donnant sur le déambulatoire la Tentation d’Adam et Ève (retrouvez ici la Tentation de la façade de Notre-Dame-la-Grande). Mes photographies ne sont pas terribles, mais vous en trouverez de plus belles sur cette page consacrée à l’art roman de Poitiers [lien actualisé].
 En voici une autre vue… pas beaucoup plus nette.
En voici une autre vue… pas beaucoup plus nette.
[PS : Ce même chapiteau a deux autres faces sculptées, avec Nabuchodonosor et un homme attaqué par un lion, à découvrir ici].
Le clocher-porche a été restauré récemment, l’occasion pour la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Poitou-Charentes de proposer un petit dossier en ligne sur le portail occidental dont je vous reparlerai une prochaine fois… comme de la crypte et du tombeau de la sainte… qui avait sauvé la ville d’un dragon, la Grande-Goule rappelez-vous, j’en ai déjà parlé et vous pouvez le voir ici sur des cartes postales anciennes (voir d’autres liens en fin d’article).
 Il y a une autre très belle bien que plus frustre représentation de Daniel dans la fosse au lion à Poitiers, sur l’un des chapiteaux du clocher-porche de l’église Saint-Porchaire… qui date à peu près de la même époque, à la fin du XIe siècle. Sur ce chapiteau, Daniel est représenté dans une mandorle (motif en forme d’amande qui symbolise Dieu et se trouve souvent associée au Christ, plus rarement à la Vierge, à des prophètes, comme ici, ou à des saints), mandorle contre laquelle les lions semblent venir s’écraser.
Il y a une autre très belle bien que plus frustre représentation de Daniel dans la fosse au lion à Poitiers, sur l’un des chapiteaux du clocher-porche de l’église Saint-Porchaire… qui date à peu près de la même époque, à la fin du XIe siècle. Sur ce chapiteau, Daniel est représenté dans une mandorle (motif en forme d’amande qui symbolise Dieu et se trouve souvent associée au Christ, plus rarement à la Vierge, à des prophètes, comme ici, ou à des saints), mandorle contre laquelle les lions semblent venir s’écraser.
[à voir désormais restauré en 2012 ici, également avec des détails de Habaquq et autres].
Articles sur l’église Sainte-Radegonde
 Mon collègue Thierry Allard vient de réaliser un article en ligne sur des œuvres du sculpteur Morice Lipsi (1898-1986). S’il est beaucoup plus connu à l’étranger qu’en France, il a laissé quelques œuvres en Poitou-Charentes et plus particulièrement à Abzac et Brillac, deux communes qui ont été étudiées dans le cadre de l’inventaire du patrimoine de la communauté de communes du Confolentais. Cet artiste s’y est réfugié pendant la seconde guerre mondiale. Retrouvez aussi d’autres œuvres de Morice Lipsi sur le site internet du Musée Morice Lipsi à Rosey en Haute-Saône et dans un dossier du Centre départemental de documentation pédagogique de la Haute-Saône. Pour des questions de droit d’auteur, je ne vous montre pas de photographies de ces sculptures, mais une vue de la briqueterie Malmanche dans le village de Chardat à Abzac, lors d’une visite organisée dans le cadre des journées du patrimoine en 2007. Dans le four d’une briqueterie voisine aujourd’hui abandonnée, Morice Lipsi a cuit quelques-unes de ses sculptures en terre.
Mon collègue Thierry Allard vient de réaliser un article en ligne sur des œuvres du sculpteur Morice Lipsi (1898-1986). S’il est beaucoup plus connu à l’étranger qu’en France, il a laissé quelques œuvres en Poitou-Charentes et plus particulièrement à Abzac et Brillac, deux communes qui ont été étudiées dans le cadre de l’inventaire du patrimoine de la communauté de communes du Confolentais. Cet artiste s’y est réfugié pendant la seconde guerre mondiale. Retrouvez aussi d’autres œuvres de Morice Lipsi sur le site internet du Musée Morice Lipsi à Rosey en Haute-Saône et dans un dossier du Centre départemental de documentation pédagogique de la Haute-Saône. Pour des questions de droit d’auteur, je ne vous montre pas de photographies de ces sculptures, mais une vue de la briqueterie Malmanche dans le village de Chardat à Abzac, lors d’une visite organisée dans le cadre des journées du patrimoine en 2007. Dans le four d’une briqueterie voisine aujourd’hui abandonnée, Morice Lipsi a cuit quelques-unes de ses sculptures en terre.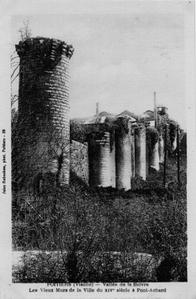
 Dans De bello Gallico (La guerre des Gaules), César mentionne un oppidum, Lemonum, capitale des Pictons. Archéologiquement, il y a peu de vestiges de cette période en ville, et il n’est pas sûr que cette cité gauloise ait été fortifiée, même si certains auteurs pensent qu’il existait un fossé gaulois dans l’actuelle rue de la Tranchée, non loin donc du rempart dont je viens de vous parler. De même, pour l’époque romaine, ce n’est que le rempart tardif, du IVe siècle de notre ère (peut-être un peu avant ?), qui est bien connu. Comme dans toute la Gaule romaine, il a été construit en partie avec des éléments provenant de monuments publics pour protéger la ville contre les invasions barbares. Il en reste un beau témoin en élévation dans le square Jeanne-d’Arc, à côté de la Tour Maubergeon, ce palais des comtes de Poitiers et ducs d’Aquitaine devenu depuis palais de justice après la Révolution. Vous pouvez aussi en retrouver des traces dans les blocs utilisés en remploi dans sa construction au sein de la section enfants de
Dans De bello Gallico (La guerre des Gaules), César mentionne un oppidum, Lemonum, capitale des Pictons. Archéologiquement, il y a peu de vestiges de cette période en ville, et il n’est pas sûr que cette cité gauloise ait été fortifiée, même si certains auteurs pensent qu’il existait un fossé gaulois dans l’actuelle rue de la Tranchée, non loin donc du rempart dont je viens de vous parler. De même, pour l’époque romaine, ce n’est que le rempart tardif, du IVe siècle de notre ère (peut-être un peu avant ?), qui est bien connu. Comme dans toute la Gaule romaine, il a été construit en partie avec des éléments provenant de monuments publics pour protéger la ville contre les invasions barbares. Il en reste un beau témoin en élévation dans le square Jeanne-d’Arc, à côté de la Tour Maubergeon, ce palais des comtes de Poitiers et ducs d’Aquitaine devenu depuis palais de justice après la Révolution. Vous pouvez aussi en retrouver des traces dans les blocs utilisés en remploi dans sa construction au sein de la section enfants de 
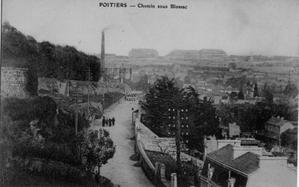 Mais au début du XXe siècle, comme vous pouvez le voir sur cette carte postale ancienne, c’était un lieu de promenade, avec un peu plus loin une cheminée de l’usine à gaz (voir commentaire ci-dessous) et de l’autre côté du Clain, les casernements militaires…
Mais au début du XXe siècle, comme vous pouvez le voir sur cette carte postale ancienne, c’était un lieu de promenade, avec un peu plus loin une cheminée de l’usine à gaz (voir commentaire ci-dessous) et de l’autre côté du Clain, les casernements militaires… La poste centrale ou grande poste de Poitiers a été construite à partir de 1910 par l’architecte poitevin Hilaire Guinet (qui y a aussi réalisé l’immeuble de la
La poste centrale ou grande poste de Poitiers a été construite à partir de 1910 par l’architecte poitevin Hilaire Guinet (qui y a aussi réalisé l’immeuble de la  Il ne fut achevé qu’en 1919, ainsi qu’en atteste la signature sur la façade. Elle est surtout remarquable pour son décor, que ce soit en façade ou à l’intérieur la mosaïque et les quatre piliers art nouveau à chapiteaux ornés. J’ai repris cet article avec
Il ne fut achevé qu’en 1919, ainsi qu’en atteste la signature sur la façade. Elle est surtout remarquable pour son décor, que ce soit en façade ou à l’intérieur la mosaïque et les quatre piliers art nouveau à chapiteaux ornés. J’ai repris cet article avec  Alors, si vous passez devant la poste, pensez à regarder le fronton et la façade sur la rue Arthur-Ranc. Par rapport à cette vue ancienne, l’installation pour le télégraphe a disparu, mais le reste est presque inchangé. Les sculptures mériteraient un petit coup de nettoyage, mais sont vraiment de qualité.
Alors, si vous passez devant la poste, pensez à regarder le fronton et la façade sur la rue Arthur-Ranc. Par rapport à cette vue ancienne, l’installation pour le télégraphe a disparu, mais le reste est presque inchangé. Les sculptures mériteraient un petit coup de nettoyage, mais sont vraiment de qualité. Le sculpteur de l’ensemble (signé et daté 1913) est Aimé Octobre, qui est né à Angles-sur-l’Anglin et a plus tard réalisé de nombreux monuments aux morts, dont celui de Poitiers situé aujourd’hui au bout de la Rue Arthur-Ranc, sur le boulevard de Verdun (je vous l’ai
Le sculpteur de l’ensemble (signé et daté 1913) est Aimé Octobre, qui est né à Angles-sur-l’Anglin et a plus tard réalisé de nombreux monuments aux morts, dont celui de Poitiers situé aujourd’hui au bout de la Rue Arthur-Ranc, sur le boulevard de Verdun (je vous l’ai  Deux grandes abbayes ont été fondées en 1059-1060 à Caen,
Deux grandes abbayes ont été fondées en 1059-1060 à Caen,  Pour l’église, n’oubliez pas d’emporter vos jumelles. Il y a de très beaux chapiteaux à admirer, mais ils sont loin… La première série se trouve dans la nef. Les grandes arcatures de la nef sont surmontées d’une corniche ornée de billettes (des sortes de petits cylindres) et d’une série de petites arcatures aveugles au-dessus de laquelle se trouve une galerie. Ce sont les colonnettes de cette galerie qui portent de très beaux chapiteaux romans. La seconde série, qui comprend un chapiteau aux éléphants, se trouve dans l’abside. Mais le visiteur doit rester à l’extérieur du chœur, composé de deux travées et de l’abside qui est donc loin et de plus, pas éclairée. Toujours dans le chœur, devant le maître autel, se trouve le tombeau de la reine Mathilde en marbre noir de Tournai (en Belgique… Si vous ne connaissez pas, allez visiter
Pour l’église, n’oubliez pas d’emporter vos jumelles. Il y a de très beaux chapiteaux à admirer, mais ils sont loin… La première série se trouve dans la nef. Les grandes arcatures de la nef sont surmontées d’une corniche ornée de billettes (des sortes de petits cylindres) et d’une série de petites arcatures aveugles au-dessus de laquelle se trouve une galerie. Ce sont les colonnettes de cette galerie qui portent de très beaux chapiteaux romans. La seconde série, qui comprend un chapiteau aux éléphants, se trouve dans l’abside. Mais le visiteur doit rester à l’extérieur du chœur, composé de deux travées et de l’abside qui est donc loin et de plus, pas éclairée. Toujours dans le chœur, devant le maître autel, se trouve le tombeau de la reine Mathilde en marbre noir de Tournai (en Belgique… Si vous ne connaissez pas, allez visiter  Cet été,
Cet été,  Ce chapiteau porte sur sa face donnant sur le déambulatoire la Tentation d’Adam et Ève (retrouvez ici
Ce chapiteau porte sur sa face donnant sur le déambulatoire la Tentation d’Adam et Ève (retrouvez ici  En voici une autre vue… pas beaucoup plus nette.
En voici une autre vue… pas beaucoup plus nette. Il y a une autre très belle bien que plus frustre représentation de Daniel dans la fosse au lion à Poitiers, sur l’un des chapiteaux du clocher-porche de l’église Saint-Porchaire… qui date à peu près de la même époque, à la fin du XIe siècle. Sur ce chapiteau, Daniel est représenté dans une mandorle (motif en forme d’amande qui symbolise Dieu et se trouve souvent associée au Christ, plus rarement à la Vierge, à des prophètes, comme ici, ou à des saints), mandorle contre laquelle les lions semblent venir s’écraser.
Il y a une autre très belle bien que plus frustre représentation de Daniel dans la fosse au lion à Poitiers, sur l’un des chapiteaux du clocher-porche de l’église Saint-Porchaire… qui date à peu près de la même époque, à la fin du XIe siècle. Sur ce chapiteau, Daniel est représenté dans une mandorle (motif en forme d’amande qui symbolise Dieu et se trouve souvent associée au Christ, plus rarement à la Vierge, à des prophètes, comme ici, ou à des saints), mandorle contre laquelle les lions semblent venir s’écraser. Deux grandes abbayes ont été fondées en 1059-1060 à Caen, l’abbaye aux hommes et
Deux grandes abbayes ont été fondées en 1059-1060 à Caen, l’abbaye aux hommes et  Dans la vaste église, qui conserve des éléments romans même si le chevet a été fortement modifié à l’époque gothique, le tombeau de Guillaume-le-Conquérant est marqué par une simple dalle de marbre, dans le chœur devant le maître autel, sans gisant.
Dans la vaste église, qui conserve des éléments romans même si le chevet a été fortement modifié à l’époque gothique, le tombeau de Guillaume-le-Conquérant est marqué par une simple dalle de marbre, dans le chœur devant le maître autel, sans gisant. Ne ratez pas dans la chapelle Halbout (à gauche en entrant par la façade), pour ses stalles du XVIIe siècle avec de très belles miséricordes (repose-fesses si vous préférez !) sculptées.
Ne ratez pas dans la chapelle Halbout (à gauche en entrant par la façade), pour ses stalles du XVIIe siècle avec de très belles miséricordes (repose-fesses si vous préférez !) sculptées.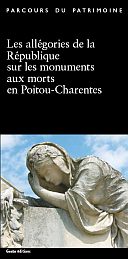 Hier soir, la Région Poitou-Charentes, et plus particulièrement le service de l’inventaire du patrimoine culturel où je travaille, a lancé au lycée professionnel du Dolmen à Poitiers (tout près du
Hier soir, la Région Poitou-Charentes, et plus particulièrement le service de l’inventaire du patrimoine culturel où je travaille, a lancé au lycée professionnel du Dolmen à Poitiers (tout près du