 C’est décidément une semaine cinéma, mais que voulez-vous, je suis pas mal sortie ces derniers temps….
C’est décidément une semaine cinéma, mais que voulez-vous, je suis pas mal sortie ces derniers temps….
12 donc, c’est une adaptation très libre par Nikita Mikhalkov (qui joue lui-même le juré n° 2, président du jury) de 12 hommes en colère, pièce écrite par Reginald Rose en 1953 et réalisée au cinéma par Sidney Lumet en 1957.
Le nouveau film se situe donc de nos jours, à Moscou. Douze hommes, douze jurés, sont amenés à débattre – si possible rapidement – pour juger un homme, un jeune Tchétchène qui a assisté il y a quelques années au meurtre de ses parents et qui est aujourd’hui accusé du meurtre de son père adoptif, un officier russe qui l’a recueilli à l’époque. Le tribunal étant en travaux, ils se retrouvent enfermés dans un gymnase d’école transformé pour l’occasion en salle de délibération alors que l’accusé patiente à côté, revivant sans cesse la guerre de Tchétchénie… Le jugement ne devrait être qu’une question de minutes, mais l’un des jurés refuse de voter la culpabilité, et les douze hommes s’embarquent pour plusieurs heures de débats (2h30 pour le film). Coupable, non coupable ?
Mon avis : j’ai beaucoup aimé la façon de Nikita Mikhalkov de traiter cette histoire. « On » le dit proche du pouvoir, mais il dresse ici un portrait sans complaisance, je trouve, de la société russe d’avant (du temps des communistes), d’aujourd’hui, des exactions en Tchéchénie, de la corruption. Mikhalkov a rassemblé douze hommes ordinaires, de tous les horizons, pas de beau gosse comme au cinéma, un reflet de la société en général… Pour la Rollex du directeur de cimetière, rien à voir avec une scène franco-française, Mikhalkov a sorti son film en 2007 en Russie… mais toute la salle a souri. D’après une interview de l’auteur que j’ai entendue il y a quelque temps dans Cosmopolitaine de Paula Jacques sur France Inter, après la sortie du film, beaucoup de procès en Russie se sont terminés par des acquittements… À voir si vous le pouvez, sinon, à découvrir sur le site officiel.
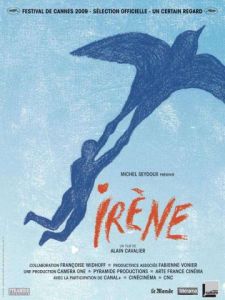 Dans le cadre du
Dans le cadre du 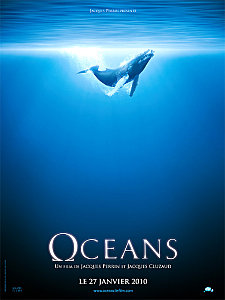 Je suis allée voir au cinéma Océans, de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. Après le peuple migrateur et les insectes, plongée dans l’océan, avec de très belles images… et des espèces que l’on ne voit pas souvent, comme les iguanes des Galapagos, observés en son temps par Darwin (avec les pinsons) dans les années 1830… et qui lui serviront de matériaux trente ans plus tard pour son traité sur l’origine des espèces (mais il n’en est pas question dans le film). Bon, pour le film, de belles images, et parfois un discours moralisateur pas très utile, avec des dialogues entre Jacques Perrin et son jeune fils Lancelot, des amalgames entre la chasse au thon et celle aux ailerons de requin (ah les Japonais…). Comme les noms des espèces ne figurent pas du tout dans le film, une petite visite (avant et/ou après) au
Je suis allée voir au cinéma Océans, de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. Après le peuple migrateur et les insectes, plongée dans l’océan, avec de très belles images… et des espèces que l’on ne voit pas souvent, comme les iguanes des Galapagos, observés en son temps par Darwin (avec les pinsons) dans les années 1830… et qui lui serviront de matériaux trente ans plus tard pour son traité sur l’origine des espèces (mais il n’en est pas question dans le film). Bon, pour le film, de belles images, et parfois un discours moralisateur pas très utile, avec des dialogues entre Jacques Perrin et son jeune fils Lancelot, des amalgames entre la chasse au thon et celle aux ailerons de requin (ah les Japonais…). Comme les noms des espèces ne figurent pas du tout dans le film, une petite visite (avant et/ou après) au 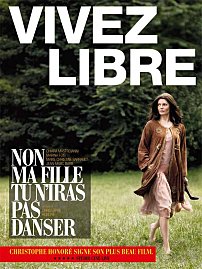 Dans le cadre du
Dans le cadre du 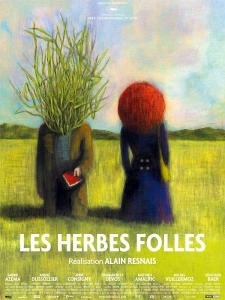 Dans le cadre du
Dans le cadre du  Dans le cadre du
Dans le cadre du 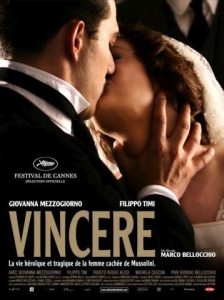 Dans le cadre du
Dans le cadre du 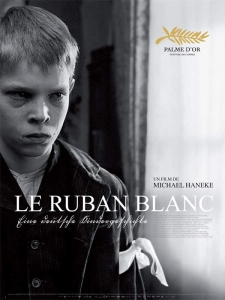 Dans le cadre du
Dans le cadre du 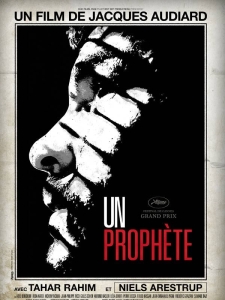 Dans le cadre du
Dans le cadre du