
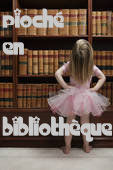 Un livre trouvé parmi les nouvelles acquisitions de la médiathèque.
Un livre trouvé parmi les nouvelles acquisitions de la médiathèque.
Le livre : Voyage à Bayonne de Gaëlle Bantegnie, collection l’arbalète, éditions Gallimard, 2012, 170 pages, ISBN 9782864248835.
L’histoire : à Angers, en juin 1998. Emmanuelle, 25 ans, jeune professeure de philosophie, est à peine plus âgée que ses élèves. Au printemps, son compagnon, Boris, a eu une aventure avec une prof de français lors d’un voyage scolaire. Jeune couple, ils s’étaient promis de ne pas s’interdire des aventures, mais face à la réalité, Emmanuelle découvre la jalousie. Pour les vacances, ils doivent partir à la découverte de l’Italie et de Pompéi, mais d’abord prendre chacun de leur côté une semaine de vacances, chez ses parents à Quimper et en compagnie de Leibniz pour Emmanuelle, qui souhaite en lire l’œuvre complète. Mais voilà que la vue d’une araignée lui déclenche une peur phobique des araignées et des insectes, qu’elle voit partout… et peu à peu aussi en hallucinations. Quand Boris la rejoint, elle refuse de partir en Italie, surtout en camping au lieu de l’hôtel prévu. Direction donc Bayonne…
Mon avis : la naissance d’une peur-panique phobique avec hallucinations est abordée à petites touches, de l’apparition des premiers symptômes, cachés par la jeune femme à ses proches, à la crise de tétanie qui entraîne la médicalisation du problème, les médicaments et le début d’une psychothérapie. Mais celle-ci n’est pas le sujet du livre, elle commence après les vacances, qui sont au cœur du récit… Comment, malgré les symptômes, sauver les vacances, comment Boris gère les premières crises publiques, sur la plage et à la pizzéria. Une écriture simple, descriptive, souvent pleine d’humour, sans parti pris pour l’un ou l’autre de ses personnages.
 D’importants travaux de fortifications et de modifications ont lieu au 16e siècle à Bayonne. En 1572, le roi de France Charles IX confie à l’ingénieur Louis de Foix le déplacement de l’embouchure de l’Adour de Vieux-Boucau à Bayonne, les travaux durent jusqu’en 1578, ce qui est assez court vu l’importance des travaux.
D’importants travaux de fortifications et de modifications ont lieu au 16e siècle à Bayonne. En 1572, le roi de France Charles IX confie à l’ingénieur Louis de Foix le déplacement de l’embouchure de l’Adour de Vieux-Boucau à Bayonne, les travaux durent jusqu’en 1578, ce qui est assez court vu l’importance des travaux. Les rives de la Nive sont aussi sympathiques.
Les rives de la Nive sont aussi sympathiques. En 1862, la ville décide de se doter de nouvelles halles, à structure métallique, à l’emplacement de plusieurs maisons. Elles furent inaugurées en 1864. Mais ce ne sont pas celles que l’on voit aujourd’hui : son toit s’effondra sous le poids de la neige en janvier 1945. Un marché-parking fut construit à cet emplacement en 1963 (il ressemblait à l’horrible marché couvert de Poitiers qui a lui aussi remplacé d’anciennes halles métalliques).
En 1862, la ville décide de se doter de nouvelles halles, à structure métallique, à l’emplacement de plusieurs maisons. Elles furent inaugurées en 1864. Mais ce ne sont pas celles que l’on voit aujourd’hui : son toit s’effondra sous le poids de la neige en janvier 1945. Un marché-parking fut construit à cet emplacement en 1963 (il ressemblait à l’horrible marché couvert de Poitiers qui a lui aussi remplacé d’anciennes halles métalliques). Le bâtiment que vous voyez sur la photo est une reconstitution de 1994 de nouvelles halles métalliques… De plus prêt, vous voyez mieux qu’elle est neuve ou presque.
Le bâtiment que vous voyez sur la photo est une reconstitution de 1994 de nouvelles halles métalliques… De plus prêt, vous voyez mieux qu’elle est neuve ou presque. La cathédrale Notre-Dame (ou Sainte-Marie) et son cloître sont classés monuments historiques depuis 1862… et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France (78 édifices sont concernés) depuis 1998. Située à l’emplacement du castrum romain, la cathédrale romane a été détruite par un incendie en 1258. Reconstruite à la fin du 13e siècle pour le chœur (abside, chapelles rayonnantes et déambulatoire), le chantier se poursuit au 14e siècle dans la nef et le transept. La façade est refaite au 15e siècle. Un nouvel incendie en 1793 l’endommage sérieusement et elle subit d’importantes restaurations au 19e siècle… L’édifice que l’on voit maintenant est donc éclectique et plus néo-gothique que gothique… Les tours de la façade et leurs flèches (de toute façon, on manque de recul pour les photographier) datent des années 1873-1878… et sont dues à Émile Boeswillwad, un architecte disciple de Viollet-le-Duc ; la grande rosace date de la fin des années 1920.
La cathédrale Notre-Dame (ou Sainte-Marie) et son cloître sont classés monuments historiques depuis 1862… et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France (78 édifices sont concernés) depuis 1998. Située à l’emplacement du castrum romain, la cathédrale romane a été détruite par un incendie en 1258. Reconstruite à la fin du 13e siècle pour le chœur (abside, chapelles rayonnantes et déambulatoire), le chantier se poursuit au 14e siècle dans la nef et le transept. La façade est refaite au 15e siècle. Un nouvel incendie en 1793 l’endommage sérieusement et elle subit d’importantes restaurations au 19e siècle… L’édifice que l’on voit maintenant est donc éclectique et plus néo-gothique que gothique… Les tours de la façade et leurs flèches (de toute façon, on manque de recul pour les photographier) datent des années 1873-1878… et sont dues à Émile Boeswillwad, un architecte disciple de Viollet-le-Duc ; la grande rosace date de la fin des années 1920. Adossé au sud de la nef, le cloître est plus intéressant (enfin, je n’ai rien contre le néo-gothique)… mais en plein travaux de restauration. C’est l’un des plus grands cloîtres gothiques (13e-14e siècles) de France, mais il faudra revenir pour le visiter. Il sert aussi de dépôt lapidaire.
Adossé au sud de la nef, le cloître est plus intéressant (enfin, je n’ai rien contre le néo-gothique)… mais en plein travaux de restauration. C’est l’un des plus grands cloîtres gothiques (13e-14e siècles) de France, mais il faudra revenir pour le visiter. Il sert aussi de dépôt lapidaire. Quitte à visiter du néo-quelque chose (gothique en l’occurrence), autant aller voir l’église Saint-André, dans le Petit-Bayonne, au style plus homogène que la cathédrale. Elle a été construite grâce à un legs de 1846 par Hippolyte Durand, architecte diocésain, et Hippolyte Guichenné, architecte, entre 1856 et 1862…
Quitte à visiter du néo-quelque chose (gothique en l’occurrence), autant aller voir l’église Saint-André, dans le Petit-Bayonne, au style plus homogène que la cathédrale. Elle a été construite grâce à un legs de 1846 par Hippolyte Durand, architecte diocésain, et Hippolyte Guichenné, architecte, entre 1856 et 1862… Aujourd’hui, les fêtes de Bayonne battent leur plein, j’espère qu’il n’y aura pas d’accident dramatique cette année.
Aujourd’hui, les fêtes de Bayonne battent leur plein, j’espère qu’il n’y aura pas d’accident dramatique cette année. Je n’ai pas eu le temps de m’approcher de la citadelle Vauban, érigée dans les années 1680 et (elle n’a pas été inscrite parmi les sites Vauban protégés par l’Unesco), inscrite comme monument historique avec ses trois demi-lunes et ses glacis en 1929. Vauban a créé une troisième ligne de fortifications et de nombreux ouvrages avancés.
Je n’ai pas eu le temps de m’approcher de la citadelle Vauban, érigée dans les années 1680 et (elle n’a pas été inscrite parmi les sites Vauban protégés par l’Unesco), inscrite comme monument historique avec ses trois demi-lunes et ses glacis en 1929. Vauban a créé une troisième ligne de fortifications et de nombreux ouvrages avancés. Vauban reprit aussi la défense du Château Vieux, dans la ville haute…
Vauban reprit aussi la défense du Château Vieux, dans la ville haute… … et du Château-Neuf, dans le Petit-Bayonne.
… et du Château-Neuf, dans le Petit-Bayonne. Je trouve que la restauration et la mise en valeur de tous ces ouvrages fortifiés, qui doivent coûter une petite fortune en entretien, sont plutôt réussies.
Je trouve que la restauration et la mise en valeur de tous ces ouvrages fortifiés, qui doivent coûter une petite fortune en entretien, sont plutôt réussies.